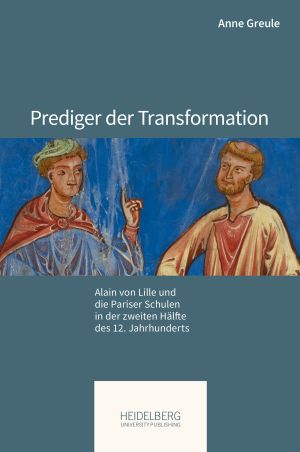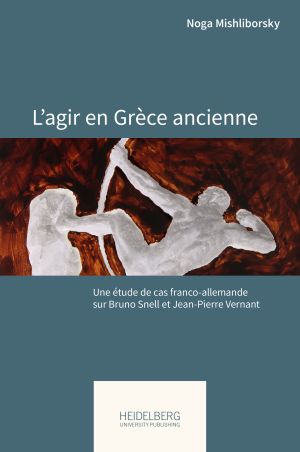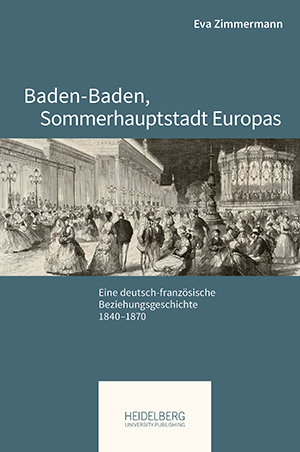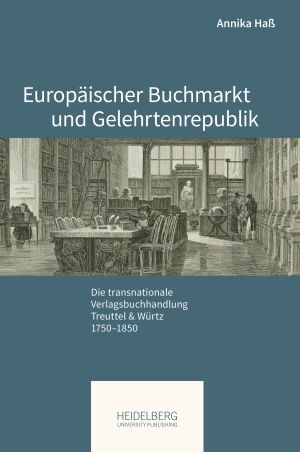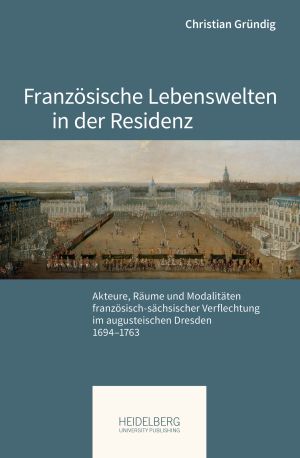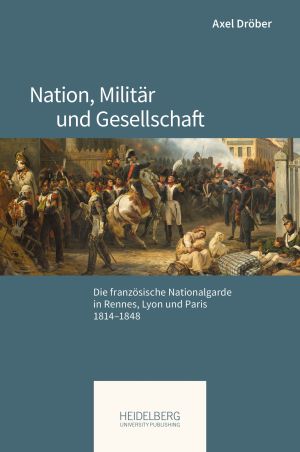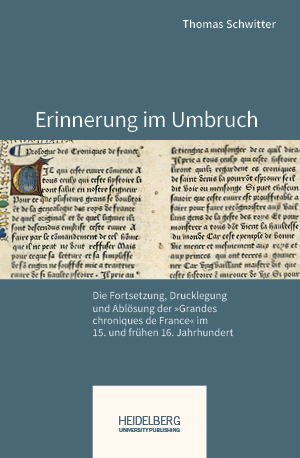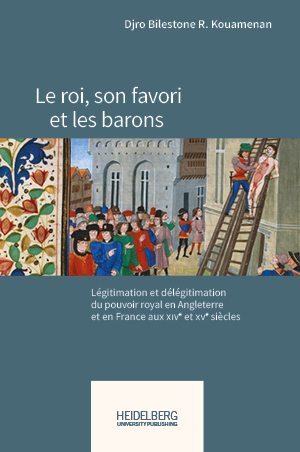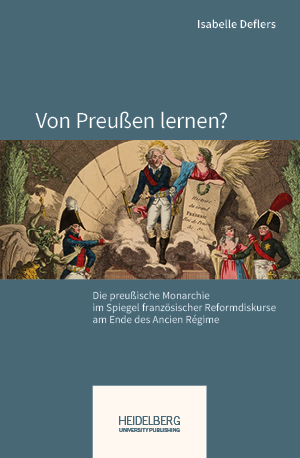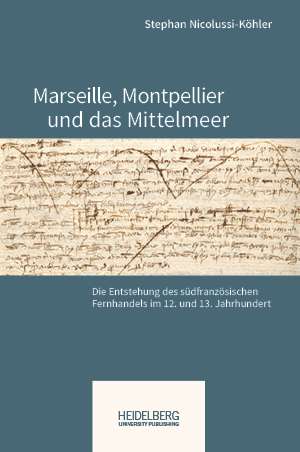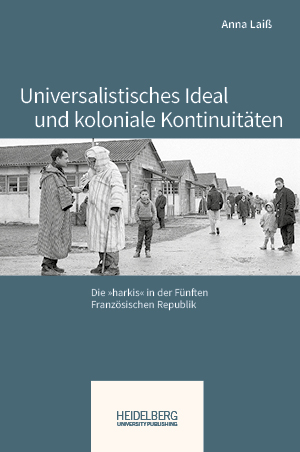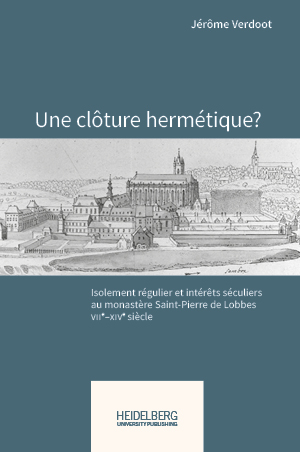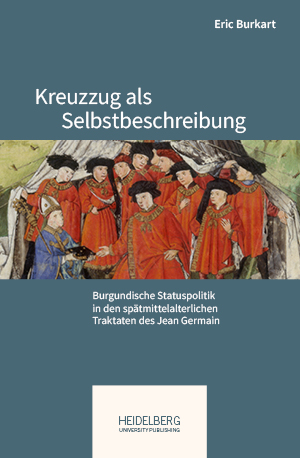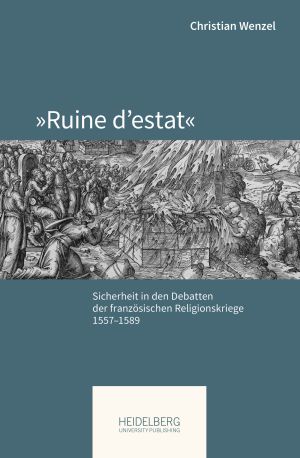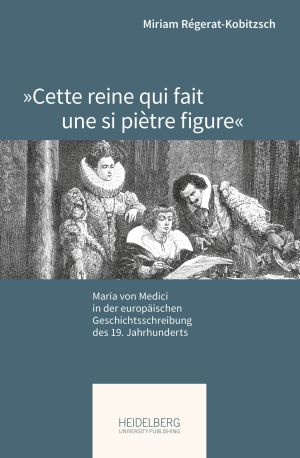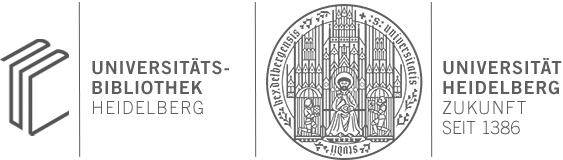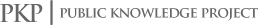Pariser Historische Studien
Die Pariser Historischen Studien (PHS) sind eine internationale Publikationsreihe, die vom Deutschen Historischen Institut Paris (DHIP) seit 1962 herausgegeben wird. Sie ist ein Forum für den akademischen Austausch zwischen deutscher und französischer Forschung und steht auch exzellenten außeruniversitären Studien offen, die in den Forschungsbereichen des DHIP angesiedelt sind. In bereits mehr als hundert Bänden bieten die PHS der Fachwelt und einer wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit ein breites Themenspektrum zur westeuropäischen und französischen Geschichte von der Spätantike bis zur Gegenwart. Ab 2019 fusionierte sie mit der ähnlich ausgerichteten zweiten Reihe des DHIP, den seit 1975 erscheinenden Beiheften der Francia. Diese beiden Publikationstraditionen werden ab der Bandnummer 115 in einer Reihe, den PHS, und mit erhöhter Sichtbarkeit durch vielfältige Verbreitungskanäle weitergeführt: frei zugängliche Forschungsergebnisse durch sofortigen Open Access – und eine Druckausgabe (Print on Demand) mit neuem Reihendesign.
Pariser Historische Studien
Herausgeber
Klaus Oschema
Redaktionsleitung
Julie Bachmann
Deutsches Historisches Institut Paris (DHIP)
Informationen zum Publizieren in den PHS (PDF)
Erscheint demnächst
La ville jurée
Um Vertrauen und Solidarität zu schaffen und die Bevölkerung zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu bewegen, banden die Städte von Konstanz bis Straßburg im Spätmittelalter Bürger und andere Einwohner in Eidesbeziehungen ein. Die Untersuchung der Eidesrituale zeigt zwar, dass die Stadt keine conjuratio gleichberechtigter Bürger, sondern eine stark hierarchisch strukturierte Gesellschaft war. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Eid seine Bedeutung verloren hätte. Indem der Eid in den Kontext einer städtischen Kultur gestellt wird, die von kirchlichen und kaiserlichen Gesetzen und Praktiken geprägt war, und indem untersucht wird, wie er sich in den umfassenden Prozess der Verschriftlichung städtischer Herrschaft einfügte, widerlegt dieses Buch die Vorstellung von seinem Niedergang und gibt ihm seine Plastizität und politische Wirksamkeit zurück.
Bisher erschienen
»Émigrés« an der Grenze: Flucht, Exil und Migrationsregime in Frankreich und Westeuropa im Zeitalter der Revolutionen 1789–1815
In den Wirren der Französischen Revolution entschlossen sich zehntausende Menschen zur Flucht in das grenznahe Ausland. Wer waren diese Flüchtlinge, die seit 1789 von den Revolutionären unter der Bezeichnung émigrés geächtet wurden? Wie gelang es ihnen, die Grenze zu überqueren und im Exil zu überleben? Welche Mittel setzten Frankreich und seine Nachbarstaaten ein, um diese Mobilität zu kontrollieren? Jort Blazejewski untersucht Motive, Verläufe und Erscheinungsformen dieser Gewaltmigration anhand zahlreicher Quellen. Die Studie eröffnet neue Perspektiven auf eine der größten Fluchtbewegungen der Vormoderne und deckt unbekannte Krisenerscheinungen des europäischen Revolutionszeitalters auf.
Prediger der Transformation: Alain von Lille und die Pariser Schulen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
Um 1200 entstand in Paris eine neue Institution des Lehrens und Lernens: die Universität. Doch wie kam es dazu, dass Lehrende sich zu einer Gemeinschaft zusammenschlossen und ihre Tätigkeit reglementierten? Ein bislang unterschätzter Akteur in diesem Transformationsprozess war der Magister Alain von Lille, dessen Predigtwerk hier erstmals umfassend vor diesem Hintergrund ausgewertet wird. Anders als lange angenommen, war er kein in die Jahre gekommener Gelehrter, der das Ende des alten Bildungsideals beklagte. Vielmehr versuchte er die im Wandel begriffenen schulischen Gemeinschaften zu stabilisieren, indem er sie auf gemeinsame Ziele, Methoden und Werte verpflichtete.
L'agir en Grèce ancienne: Une étude de cas franco-allemande sur Bruno Snell et Jean-Pierre Vernant
Welche Verbindung gibt es zwischen der griechischen Antike und der Welt von heute? Zwischen den wissenschaftlichen Analysen eines Forschers, seinen Überzeugungen und seinem Leben als Bürger? Zwischen der philologischen Reflexion darüber, wie Figuren bei Homer und in der griechischen Tragödie Entscheidungen treffen, und dem Engagement von Intellektuellen während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich und Deutschland? Zwischen dem deutschen Philologen Bruno Snell, der vom Winckelmann‘schen Idealismus und einer von Wilamowitz geerbten wissenschaftlichen Praxis geprägt war, und Jean-Pierre Vernant, einem französischen Philosophen und Anthropologen mit marxistischen Ansichten? Dieses Buch zeigt auf nuancierte Weise, wie diese scheinbar weit voneinander entfernten Bereiche und Personen sich begegnen.
Baden-Baden, Sommerhauptstadt Europas: Eine deutsch-französische Beziehungsgeschichte, 1840–1870
Zwischen Mitte der 1840er-Jahre und dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 avancierte der Kurort Baden-Baden zum führenden Modebad Europas und zu einem bedeutenden interkulturellen Zentrum. Der ausgeprägte französische Einfluss brachte der Stadt auf beiden Seiten des Rheins den Ruf einer »französischen Kolonie« und einer »Filiale von Paris« ein, wobei dies unterschiedlich interpretiert wurde. Eva Zimmermann geht der Entwicklung dieses einzigartigen Ortes der deutsch-französischen Kulturbeziehungen im Spannungsfeld zwischen Kosmopolitismus und erstarkendem Nationalismus nach. Sie analysiert die vielfältigen Faktoren, die zur Entstehung der »Sommerhauptstadt Europas« beitrugen, und identifiziert Phänomene und Grenzen des Austauschs und Kulturtransfers, welche die gesamte Bäderkultur prägten.
Europäischer Buchmarkt und Gelehrtenrepublik: Die transnationale Verlagsbuchhandlung Treuttel & Würtz, 1750–1850
Die Verlagsbuchhandlung Treuttel & Würtz war um 1800 eine Drehscheibe des europäischen Austauschs par excellence. Während der Verlag mit Publikationen von Johann Wolfgang von Goethe oder Germaine de Staël ein transkulturelles Elitepublikum anvisierte, belieferte die Buchhandlung mit ihren Filialen in Straßburg, Paris und London sowie ihrem weit verzweigten Handelsnetzwerk Kunden in ganz Europa. Erstmals werden in dieser Studie Funktionsweise und Einfluss der Verlagsbuchhandlung untersucht und in den kulturhistorischen Kontext eingebettet: von der Organisation des Buchhandels und den Kooperationen der Buchhändler über Bibliotheksgeschichte bis zur Entstehung neuer akademischer Disziplinen wie der modernen Philologien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. All diese Bereiche zeichneten sich durch einen transnationalen Markt aus, der von Treuttel & Würtz in einer Weise bedient wurde, die als praktizierte Weltliteratur bezeichnet werden kann.
Französische Lebenswelten in der Residenz: Akteure, Räume und Modalitäten französisch-sächsischer Verflechtung im augusteischen Dresden, 1694‒1763
In der augusteischen Epoche (1694–1763) entwickelte sich die sächsische Residenzstadt Dresden zu einem kulturellen Zentrum des Reichs. Neue Personennetzwerke und Handelswege setzten Wissenstransfers in Gang, wobei die Verbindung zu Frankreich eine herausragende Rolle einnahm. Diese Studie richtet daher den Blick auf die Vielzahl der Französinnen und Franzosen, die für kurze oder längere Zeit in die sächsische Hauptstadt kamen. Anhand von zahlreichen Quellen aus deutschen und französischen Archiven werden die in Frankreich liegenden Voraussetzungen dieser Reisen, die sozialen Modalitäten und schließlich das französische Wirken am Hof und in der Stadt betrachtet. Dadurch entsteht ein facettenreiches, akteurszentriertes Bild des französisch-sächsischen Kulturtransfers.
Nation, Militär und Gesellschaft: Die französische Nationalgarde in Rennes, Lyon und Paris, 1814–1848
Die aus der Revolution hervorgegangene Nationalgarde prägte das öffentliche Leben und die Institutionen Frankreichs nachhaltig. Für die 1814 restaurierte Monarchie war sie eine unverzichtbare Ordnungsmacht und nahm in der politischen Außendarstellung der Bourbonen einen zentralen Platz ein. Gleichzeitig war sie zu einem Ausweis politischer Mündigkeit und sozialer Distinktion geworden. Sie vermittelte bürgerliche Identität und gesellschaftlichen Status, worauf auch das folgende Regime von Louis-Philippe aufbaute. Axel Dröber geht der Geschichte der Nationalgarde von Rennes, Lyon und Paris während Restauration und Julimonarchie nach. Er untersucht die Organisationsformen der bewaffneten Bürger und ihr Verhältnis zu Verwaltung und Regierung. Im Vordergrund steht das Erbe der Französischen Revolution, das die Gesellschaft bis weit in das 19. Jahrhundert hinein prägte und einen bleibenden Einfluss auf Disziplin und Gehorsam innerhalb der Ordnungstruppen des Landes hatte.
Erinnerung im Umbruch: Die Fortsetzung, Drucklegung und Ablösung der »Grandes chroniques de France« im 15. und frühen 16. Jahrhundert
Die Studie zeichnet die Entwicklung der herrschaftsnahen Historiografie Frankreichs im 15. und frühen 16. Jahrhundert nach. Im Fokus steht dabei in den zwei ersten Teilen die Fortsetzung und Drucklegungen der »Grandes Chroniques« im 15. Jahrhundert bis hin zur Ablösung dieses Leittextes durch die neuen, humanistisch geprägten Werke von Robert Gaguin und Paulus Aemilius. Dazwischen werden zahlreiche Entwicklungsstufen rekonstruiert und auch bislang kaum untersuchte Werke thematisiert. Das Hauptthema der französischen Historiografie war in jener Zeit lange die damals jüngere Vergangenheit, das heißt der französische Bürgerkrieg (1407–1435) und der damit verbundene Konflikt mit den englischen Königen. Das Ringen verschiedener Parteien um die Deutungshoheit über jene Jahrzehnte prägte deshalb die Entwicklung der französischen Historiografie im 15. und frühen 16. Jahrhundert maßgeblich, was im dritten Teil der Arbeit untersucht wird.
Le roi, son favori et les barons: Légitimation et délégitimation du pouvoir royal en Angleterre et en France aux XIVe et XVe siècles
Die politische Rolle des Favoriten und die Art seiner Beziehung zum König sind in der Forschung oft nicht klar gesehen worden, da in den Diskursen des frühen und späten Mittelalters die besondere Nähe zum Herrscher regelmäßig in der Sprache der Liebe und in Gesten der körperlichen Nähe und Intimität zum Ausdruck kam. So entstand der Eindruck, dass der König aus homosexueller Neigung seinem Günstling übermäßigen Einfluss gewährte – auf Kosten der Barone, die ebenfalls einen Anteil an der Macht beanspruchten.
In dieser Studie wird die Figur des Favoriten neu betrachtet und in ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinaus verständlich gemacht. Sie setzt den Vorwurf sexuellen Fehlverhaltens als politisches Argument in Bezug zur Entwicklung der Vorstellung von Königtum und Herrschaft und eröffnet so neue Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen im Spätmittelalter.
Von Preußen lernen? Die preußische Monarchie im Spiegel französischer Reformdiskurse am Ende des Ancien Régime
Der Siebenjährige Krieg war eine Katastrophe für das Ansehen Frankreichs. Um den Vorrang der französischen Monarchie im internationalen Staatensystem wiederherzustellen und das Land vor dem Bankrott zu retten, setzte eine intensive Diskussion über Reformideen ein. Die Selbstinszenierung Friedrichs II. weckte in der französischen Öffentlichkeit ein besonders lebhaftes Interesse für Preußen. Aber inwiefern konnte der als erfolgreich wahrgenommene preußische Staat als Modell in dieser Reformdebatte wirken? Die Studie zeigt, über welche Wege und Träger und mit welchen Mitteln in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime der Wissenstransfer von Preußen nach Frankreich stattfand. Die Grenzen dieses Wissenstransfers werden ebenso dargelegt wie die Funktion, die der Verweis auf Preußen innerhalb selbstreferenzieller Diskussionen um die »Regeneration« der französischen Monarchie tatsächlich eingenommen hat.
Marseille, Montpellier und das Mittelmeer: Die Entstehung des südfranzösischen Fernhandels im 12. und 13. Jahrhundert
Wie hat die Vernetzung lokaler südfranzösischer Kaufleute zum kommerziellen Aufschwung der Städte Marseille und Montpellier im 12. und 13. Jahrhundert beigetragen? Wie hat das Binnenland durch die Bereitstellung von Waren, Kapital und Menschen den expandierenden Mittelmeerhandel der größeren Küstenstädte ermöglicht? Der Ursprung des Fernhandels wird in dieser Studie nicht nur mit der Errichtung der Kreuzfahrerherrschaften im Osten erklärt, sondern direkt an seiner Wurzel erforscht, nämlich an den lokalen Handelskreisläufen im Hinterland der Hafenstädte. In mikrohistorischen Untersuchungen zu bestimmten Kaufmannsfamilien, Handelsschiffen und Handelsprivilegierungen werden bisher unbekannte Verbindungen zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren zum Vorschein gebracht und so neue Sichtweisen auf die Entwicklung des südfranzösischen Fernhandels im Mittelalter eröffnet.
Universalistisches Ideal und koloniale Kontinuitäten : Die »harkis« in der Fünften Französischen Republik
Mit der Unabhängigkeit Algeriens im Jahr 1962 verließen nicht nur eine Million europäische Siedler das Land in Richtung Frankreich, sondern auch etwa 85 000 »harkis«: Muslime, die während des Krieges insbesondere als Hilfssoldaten die französische Armee unterstützt hatten. Kamen die »harkis« als »Verräter an der algerischen Nation«, als »gleichberechtigte französische Staatsbürger« und somit als Repatriierte, oder waren sie als Flüchtlinge anzusehen? Anna Laiß analysiert die von unterschiedlichen Fremdbildern geprägten Kontroversen sowie die damit verbundene schwierige Suche der »harkis« und deren Nachkommen nach ihrem Platz in der Französischen Republik. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen universalistischem Ideal und kolonialen Handlungs- und Denkweisen auf, die sich in dem weit über die Dekolonisation hinausreichenden Untersuchungszeitraum in den Debatten um Integration und koloniale Erinnerungen wiederfinden.
Une clôture hermétique? Isolement régulier et intérêts séculiers au monastère Saint-Pierre de Lobbes, VIIe–XIVe siècle
Im Mittelalter rechtfertigten die Benediktinerabteien ihre Existenz durch ihre Isolation von der Welt. Um zu überleben, mussten die Abteien der umgebenden Bevölkerung Waren oder Dienstleistungen abgewinnen (Oblaten, Nahrung, Schutz...) und dafür andere zur Verfügung stellen (politische Unterstützung, Gastfreundschaft...). Mittelalterliche Klöster waren daher tief in die Gesellschaft integriert, auch wenn sie vorgaben, von der Gesellschaft isoliert zu sein. Dieses Paradoxon des klösterlichen Lebens wird in den Ordensforschungen häufig erwähnt, viel seltener jedoch in den Arbeiten zu einzelnen Ordenseinrichtungen. Ziel dieses Buches ist es, diesen theoretischen Rahmen mit der Realität zu konfrontieren, in der die Mönche der Abtei Saint-Pierre in Lobbes (Hennegau, Belgien) seit der Gründung dieses Klosters (7. Jh.) bis zum Ende des 14. Jahrhunderts gelebt haben. Konkret werden die Wechselwirkungen zwischen der Abtei und ihrem politischen und wirtschaftlichen Umfeld analysiert.
Verwandtsein und Herrschen: Die Königinmutter Catherine de Médicis und ihre Kinder in Briefen, 1560–1589
Catherine de Médicis war fast 30 Jahre lang eine zentrale politische Figur der französischen Monarchie. Ihre Autorität beruhte auf ihrer Position als Königinmutter. Die Studie geht der Frage nach, was Verwandtsein für sie und ihre Nachkommen war, wie verwandtschaftliche Beziehungen ausgehandelt wurden und wie Verwandtsein und Herrschen in der Praxis zusammenhingen. Was war eine Königinmutter, ein königlicher Sohn oder eine königliche Schwester? Die Briefe, die sich Mutter und Kinder schrieben, machen Verwandtschaft als flexibles Repertoire politischen Denkens und Handelns sichtbar. In einer Epoche, die als Entstehungszeit moderner Staaten betrachtet wird, wurde so Königsherrschaft in verwandtschaftlichen Beziehungen immer wieder neu konzeptualisiert und legitimiert.
Kreuzzug als Selbstbeschreibung : Burgundische Statuspolitik in den spätmittelalterlichen Traktaten des Jean Germain
Die Geschichte der Valois-Herzöge von Burgund kann aus der Retrospektive zu einer Gegenüberstellung von modernen und mittelalterlichen Elementen dieser Herrschaftsbildung verleiten. Insbesondere die Kreuzzugspläne Philipps des Guten (1419–1467) erscheinen vor dieser Folie wie das letzte Aufblühen einer mittelalterlichen Kultur, die nicht recht zum klassischen Narrativ eines »burgundischen Staates« passen will. Statt in Philipp aber einen Don Quijote des 15. Jahrhunderts oder den Vorläufer des »letzten Ritters« Maximilian zu sehen, untersucht die Studie seine Kreuzzugsprojekte als Bestandteil einer burgundischen Statuspolitik: Die ostentative Bereitschaft zur Verteidigung des Glaubens erlaubte der jungen Dynastie, eine Höherrangigkeit im Kreis der europäischen Fürsten zu beanspruchen. Zur Analyse des burgundischen Kreuzzugsdiskurses stützt sich die Arbeit auf drei Traktate des Jean Germain († 1461), die er als Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies verfasste. Methodologisch betritt sie dabei Neuland, indem eine sequenzanalytische Methode der rekonstruktiven Sozialforschung mit einer diskursanalytischen Perspektive verbunden und zur Untersuchung spätmittelalterlicher Handschriften herangezogen wird.
» Ruine d'estat «: Sicherheit in den Debatten der französischen Religionskriege 1557–1589
Sicherheit – ein für die französischen Religionskriege ebenso zentrales wie noch weitgehend unerforschtes Thema. Christian Wenzel analysiert Vorstellungen von Sicherheit sowie ihre Funktion in den französischen Religionskriegen erstmals systematisch und mit Blick auf zeitgenössische Deutungsmuster. Anschaulich zeichnet die Studie eine breite Sicherheitsdebatte nach, die die Konflikte zwischen 1557 und 1589 maßgeblich prägte. Das ermöglicht nicht nur eine neue Perspektive auf zentrale Ereignisse und Prozesse, sondern leistet mit dem hier entwickelten Konzept der »historischen Sicherheitskommunikation« auch einen Beitrag zur historischen Sicherheitsforschung und zeigt die Vielschichtigkeit frühneuzeitlicher Sicherheitsvorstellungen.
»Cette reine qui fait une si piètre figure«: Maria von Medici in der europäischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts
Die französische Königin Maria von Medici (1575–1642) blieb der Nachwelt als unfähig, machtbesessen und mutmaßliche Gattenmörderin in Erinnerung. Ihr kulturelles und politisches Wirken wurde in der Geschichtsschreibung häufig zu einer weiblichen und italienischen Klammer zwischen der Herrschaft Heinrichs IV. und dem Ministeriat Richelieus reduziert. Dieses Bild überdauerte die Revolution von 1789 und verfestigte sich im identitätsstiftenden historischen Diskurs einer sich zunehmend bürgerlich, republikanisch und laizistisch definierenden französischen Nation.
Die bewegte Rezeption der zweiten Medici-Regentin im 19. Jahrhundert ist hier erstmals Gegenstand einer Untersuchung. Sie bietet tiefe Einblicke in die Verquickung von Historiographie, Gesellschaft und Politik in der europaweiten Krisen- und Umbruchszeit des Nationalismus.